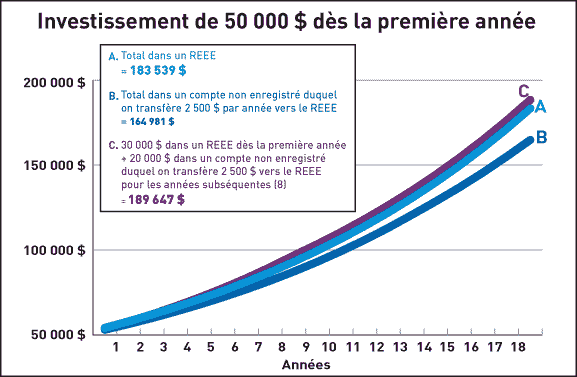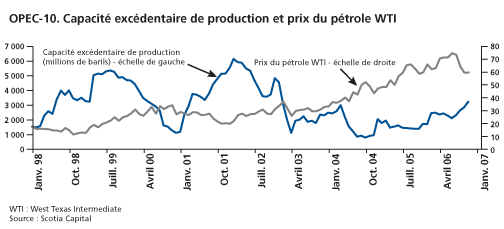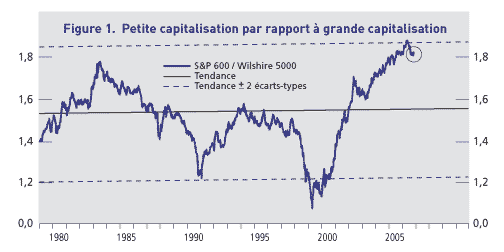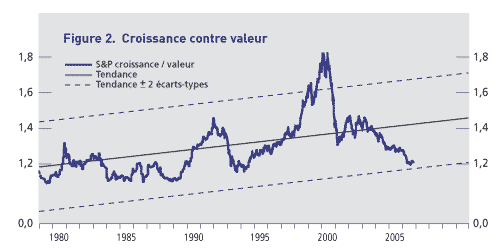La nouvelle année marque le début des « campagnes REER » des différents établissements financiers qui, jusqu’à la fin de février, vont inonder les médias imprimés et électroniques d’annonces publicitaires vantant les mérites et les avantages de leurs produits de placement et d’épargne pour vous assurer une retraite confortable.
Dès lors, il est difficile, voire impossible d’ignorer l’existence du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ni de douter de son utilité certaine pour mettre de l’argent de côté, à l’abri des impôts, en vue de la fin de votre vie professionnelle active. En plus de profiter d’une déduction du revenu imposable établie en fonction des cotisations versées, toute personne qui détient un REER tire avantage de revenus non imposés, à la condition cependant que l’argent versé y demeure.
Aux fins des déclarations de revenus de 2007, la date limite de cotisation à un REER est le 29 février 2008, soit le 60e jour de l’année. La cotisation maximale est égale à 18 % des revenus admissibles de 2007, jusqu’à un maximum de 19 000 $, MOINS le facteur d’équivalence (FE) pour les personnes participant à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de participation différé aux bénéfices (RPDB), PLUS les droits de cotisation inutilisés et reportés. Le montant des cotisations auquel vous avez droit est indiqué dans votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
CONSEIL 1 – FAITES-LE EN DÉBUT D’ANNÉE… PEU IMPORTE LES MARCHÉS !
Il est possible de cotiser à un REER dès le début de l’année d’imposition en cours. La cotisation maximale permise est 20 000 $ en 2008, elle sera 21 000 $ en 2009 et 22 000 $ en 2010. Par la suite, ce plafond sera indexé annuellement.
Si vous disposez de liquidités vous permettant de cotiser à votre REER en tout début d’année, faites-le! Ne vous laissez pas distraire par les aléas des marchés financiers ni par le fait que vous n’avez pas le temps de rencontrer votre conseiller avant de faire un choix judicieux. Au besoin, optez pour un véhicule de placement à court terme, du type marché monétaire, à l’intérieur du REER. De cette façon, votre investissement croîtra immédiatement à l’abri de l’impôt. Par la suite, vous pourrez transférer votre argent vers un autre véhicule de placement à plus long terme, toujours à l’intérieur du REER. Vous pourrez alors procéder graduellement ou d’un seul coup.
CONSEIL 2 – NE PERDEZ PAS DE VUE LES RENDEMENTS !
Nous ne cesserons jamais de répéter qu’attendre la date limite permise pour cotiser est une décision malavisée et très lourde de conséquences sur le plan financier. Pourquoi? Parce que les retardataires ne profitent pas pleinement des rendements. Or, ceux-ci sont un élément très important à considérer.
Ne pas tenir compte des rendements et ne penser qu’aux seules économies d’impôt constituent la meilleure façon d’évaluer incorrectement vos placements. À titre d’exemple, le tableau ci-dessous permet d’évaluer la différence entre les revenus accumulés en raison de contributions annuelles de 19 000 $ (la cotisation maximale permise pour l’année d’imposition 2007) effectuées en début d’année, et dont les rendements annuels composés moyens sont respectivement de 6 %, 7 % et 8 %.
|
RENDEMENTS
|
Nombre d’années
dans le REER |
6 %
|
7 %
|
8 %
|
|
10
|
265 461 $
|
280 888 $
|
297 264 $
|
|
15
|
468 778 $
|
510 873 $
|
557 161 $
|
|
20
|
740 862 $
|
833 438 $
|
939 036 $
|
|
25
|
1 104 971 $
|
1 285 853 $
|
1 500 134 $
|
|
30
|
1 592 232 $
|
1 920 388 $
|
2 324 571 $
|
|
35
|
2 244 296 $
|
2 810 356 $
|
3 535 941 $
|
CONSEIL 3 – PORTEZ ATTENTION AUX HONORAIRES DE GESTION !
Même si vous décidez de cotiser à votre REER à la toute la dernière minute, prenez le temps de vous informer des honoraires de gestion, sans quoi vous risquez de vous pénaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que la moindre différence a des répercussions énormes sur les rendements à long terme. En effet, une simple différence de 2 % entre les frais de gestion de deux fonds communs de placement équilibrés similaires offrant des rendements comparables (p. ex. l’un exigeant des frais de gestion de 1 % et l’autre 3 %) représentera, après 35 ans, une différence de 58 % quant à l’actif accumulé (3,1 M$ contre 1,9 M$).
CONSEIL 4 – COTISEZ AU REER DE VOTRE CONJOINT !
Malgré les modifications fiscales permettant le fractionnement du revenu entre conjoints à la retraite, il peut être avantageux de cotiser au REER de votre conjoint. Si vous prévoyez que votre revenu à la retraite sera supérieur à celui que votre conjoint aura, vous devriez envisager sérieusement de cotiser à son REER! En effet, en y versant des cotisations jusqu’à concurrence du montant maximal permis auquel vous avez droit, vous bénéficierez d’une déduction identique à celle que vous auriez obtenue en cotisant à votre propre REER, et ce, sans affecter les droits de cotisation de votre conjoint.
Bien entendu, lorsque le moment sera venu d’encaisser le REER, seule la personne qui le détient sera imposée sur le montant du retrait. Si vos revenus annuels sont inférieurs, vous aurez moins d’impôts à payer.
De plus, si votre conjoint est plus jeune que vous, l’argent pourra demeurer dans son REER plus longtemps, la limite étant fixée à la fin de l’année de ses 71 ans.
CONSEIL 5 – COTISEZ MAINTENANT, DEMANDEZ LA DÉDUCTION PLUS TARD !
Beaucoup d’investisseurs l’ignorent, mais il est possible de cotiser à un REER dès le début de l’année d’imposition en cours. Fixée à 19 000 $ pour 2007, la cotisation maximale permise sera de 20 000 $ en 2008, de 21 000 $ en 2009, et de 22 000 $ en 2010. Par la suite, ce plafond sera indexé annuellement.
Si votre taux d’imposition est peu élevé (en raison d’un congé de maternité, d’un congé sabbatique, d’un retour aux études, etc.) et que vous prévoyez déclarer un revenu moindre en 2007, vous auriez intérêt à cotiser la somme maximale permise à votre REER. Pourquoi? Parce que même si vous le faites, vous ne serez pas tenue pour autant d’utiliser la déduction pour l’année d’imposition correspondante. Vous pourriez, par exemple, faire fructifier vos investissements à l’abri de l’impôt immédiatement, puis utiliser la déduction quelques années plus tard, lorsque votre taux marginal d’imposition sera vraisemblablement supérieur. Votre remboursement d’impôt n’en sera alors que plus important.
Cette façon de faire est intéressante dans la mesure où vous commencez à investir dans un REER, mais que vos revenus, quoique limités, risquent d’augmenter de façon significative dans un proche avenir. C’est notamment le cas des étudiants ou des personnes qui bénéficient d’un congé parental.
Avant de reporter une déduction REER à une année ultérieure, prenez le temps de faire faire une simulation fiscale afin de bien évaluer toutes les répercussions de votre choix. Ne vous fiez pas uniquement à votre taux d’imposition marginal pour estimer l’économie d’impôt que vous réaliseriez en cotisant à votre REER. Vous devez tenir compte également des nombreux crédits d’impôts et d’autres allégements fiscaux qui, à compter d’un certain seuil de revenu, sont restreints, voire carrément éliminés. Faire appel à l’expertise d’un professionnel serait donc une sage décision.
CONSEIL 6 – UTILISEZ TOUS VOS DROITS DE COTISATION !
Si vous êtes de ceux qui n’ont pas versé les cotisations maximales autorisées à leur REER depuis 1991, vous devez savoir que vous pouvez ajouter une somme correspondant à vos droits de cotisation inutilisés. Pour la connaître, consultez votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada.
CONSEIL 7 – CONSTITUEZ-VOUS UN « COUSSIN » !
En terminant, sachez qu’il est également permis de cotiser jusqu’à 2 000 $ en sus des cotisations mentionnées précédemment, sans pénalité. Bien qu’il ne soit pas déductible dans l’année, ce « coussin » produit des revenus à l’abri de l’impôt, tant et aussi longtemps que la somme investie demeure dans votre REER. Quant à la cotisation, elle devra être déduite de votre revenu au cours d’une année à venir, au plus tard la dernière pour laquelle vous disposerez de droits de cotisation.
Vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le REER ou sur d’autres produits et services financiers? Communiquez avec nos professionnels. Ils se feront un plaisir de vous aider.
| Vous pratiquez en société?
Comme pour tous les travailleurs qui ne participent pas à un régime de pension agréé, si votre pratique médicale se fait dans le cadre d’une société, et que vous souhaitez pouvoir cotiser au maximum à votre REER en 2009 (21 000 $), vous devrez prévoir vous verser un SALAIRE (revenu gagné admissible) de 116,667 $ en 2008 (116,667 $ x 18 % = 21 000 $) |
|
Tout au long de l’année 2007, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a publié une chronique financière dans chaque numéro du Médecin du Québec. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre aux questions qui suivent. Toutes les réponses ont été données dans un article de notre chronique en cours d’année.
| Q : |
Quelles sont les sommes maximales permises à titre de cotisations au REER
pour les années d’imposition suivantes: |
|
Année 2007 : a) 10 000 $ b) 19 000 $ c) 16 500 $
Année 2008 : a) 11 000 $ b) 20 000 $ c) 19 000 $ |
| R : |
Pour l’année 2007, 19 000 $ et pour l’année 2008, 20 000 $ (janvier 2007). |
| Q : |
Concernant le prix du pétrole, pouvez-vous associer les années suivantes aux
événements qui ont eu cours? |
|
1998-1999
2000
2001-2002
2003
La crise asiatique
La récession mondiale
Le boom
La reprise économique
|
| R : |
1998-1999 = la crise asiatique
2000 = le BOOM
2001-2002 = la récession mondiale
2003 = la reprise économique
(Juin 2007). |
| Q : |
Lequel des énoncés suivants concerne le calcul du rapport cours/bénéfice ?
a) Le dividende annuel par action divisé par le cours du marché de l’action
b) Le cours d’une action ordinaire divisé par le bénéfice par action
c) Le bénéfice net moins les dividendes privilégiés divisé par le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation |
| Q : |
À combien s’élève le plafond cumulatif des subventions fédérales accordées dans un régime enregistré d’épargne-études ?
a) 4 000 $
b) 7 200 $
c) Aucun plafond cumulatif
|
| R : |
b) Le plafond cumulatif s’élève à 7 200 $ par bénéficiaire (septembre 2007). |
| Q : |
Sur la première tranche de 2 500 $ cotisés annuellement dans un REEE, quel pourcentage le Gouvernement du Québec accorde-t-il à titre de subvention ?
a) 5 %
b) 15 %
c) 10 % |
| R : |
c) La subvention est établie à 10 % des premiers 2 500 $ cotisés annuellement au régime d’un bénéficiaire (septembre 2007). |
| Q : |
Considérant qu’un investisseur est imposé au taux marginal le plus élevé (48,2 %), à combien sont imposés ses revenus de placement :
sous forme d’intérêts : a) 50 % b) 48,2 % c) 45 %
sous forme de dividendes : a) 48,2 % b) 35 % c) 29,7 %
|
| R : |
Sous forme d’intérêts, le taux d’imposition d’un revenu est 48,2 % alors que sous forme de dividendes, le taux d’imposition est 29,7 %. (novembre 2007) |
Toute l’équipe de la société vous souhaite de joyeuses fêtes !
Bon nombre d’investisseurs en ont mare des rendements de 4 à 5 % offerts présentement par les titres à revenu fixe et salivent rien qu’à l’idée d’obtenir 10 % par année. Lorsque ces derniers découvrent que les fonds de dividendes d’actions canadiennes ont procuré en moyenne (en date de septembre 2007) une performance annuelle de 14,8 % en 5 ans, de 10,3 % en 10 ans et de 11,9 % en 15 ans, ils sont estomaqués.
Est-ce trop beau pour être vrai ? Bien sûr que non, car les dividendes sont synonymes de profitabilité. Pourquoi ? Parce que les actionnaires détiennent les droits de propriété de l’entreprise et en partagent ainsi les succès et les revers. Alors, lorsqu’une société réussit à rentabiliser ses opérations, son premier réflexe sera généralement de chouchouter ses porteurs de parts en leur versant des dividendes.
La générosité des entreprises dans la distribution de cette gratification dépend en premier lieu de ses propres besoins. Dans le cas de sociétés parvenues à un stade de maturité, c’est-à-dire les Blue Chips, une grande partie du bénéfice sera versée en dividendes. Par contre, si les entreprises sont jeunes et en pleine croissance, l’essentiel des profits pourrait servir à en financer l’essor.
Le pourcentage du bénéfice net versé en dividendes varie donc énormément d’une entreprise à l’autre. Toutefois, une chose est certaine, un rendement en dividendes élevé (montant des dividendes/cours de l’action) caractérise généralement une entreprise rentable, bien établie et solide. Au Canada, les sociétés les plus généreuses avec leurs actionnaires évoluent dans les services financiers, les télécommunications et les services publics. Il s’agit donc de placements assez conservateurs qu’un investisseur peut détenir à long terme.
Une autre caractéristique non négligeable est que l’accroissement des dividendes est de nature à provoquer une montée du prix de l’action. La politique de versement de dividendes est donc un facteur clé influençant la valeur d’une entreprise. Ainsi, certaines sociétés, telles que Power Corporation, Banque Royale et Banque Nationale, se sont taillées une réputation appréciable auprès des investisseurs en raison de la constance avec laquelle le flot de dividendes s’est accru ces dernières années.
Dans l’ensemble, cependant, le rendement en dividendes a fléchi au fil des ans au Canada. De 1960 à 1998, le dividende annuel moyen de l’indice phare canadien s’est établi à 3,4 %, révèle l’étude Évolution récente des marchés d’actions et ses conséquences, publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mais le taux a reculé depuis et s’élevait à 2,44 % le 30 mars dernier. Ce repli s’explique en grande partie par le fait que de plus en plus d’entreprises augmentent la valeur de leurs actions (et avantagent les actionnaires) en rachetant les titres en circulation à même leurs bénéfices.
Une dernière particularité des dividendes est que leur traitement fiscal est avantageux. En effet, le taux maximal d’imposition des dividendes versés par les sociétés ouvertes s’élève actuellement à 29,7 % au Québec, comparativement à 48,2 % pour les revenus d’intérêt. C’est donc un placement encore plus intéressant lorsqu’il ne fait pas partie d’un REER.
Choisir avec doigté
Avec un tel profil, pas étonnant que les fonds de dividendes soient en vogue. Leur popularité s’appuie sur les qualités suivantes : constance des rendements, limitation du risque, régularité des revenus et fiscalité avantageuse des dividendes et du gain en capital.
Le risque qui guette cependant les investisseurs est d’être ébahis par ces qualités et, conséquemment, ne pas sélectionner ces fonds diligemment. Pourquoi est-ce important de bien choisir? Parce que cette catégorie de fonds englobe des portefeuilles très différents les uns des autres, puisque l’actif peut être canalisé dans les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts de fiducies de revenu ou les obligations corporatives.
Les composantes clés de ces fonds sont bien entendu les actions ordinaires et privilégiées. Qu’est-ce à dire? Les actions privilégiées sont une action de type particulier qui rapporte un montant fixe de dividendes, puisé à même les profits de l’entreprise. Leur nom signale qu’elles ont priorité sur les actions ordinaires en ce qui concerne le paiement des dividendes. Elles sont en quelque sorte un titre hybride, plus sécuritaire que les actions ordinaires, mais plus risqué que les obligations corporatives.
Bien que les gestionnaires de fonds de dividendes mettent l’emphase sur ces titres, il y a un hic, et il est de taille : les actions ordinaires munies de dividendes élevés et les actions privilégiées sont souvent émises par les mêmes entreprises canadiennes. Par conséquent, les fonds pourraient dépendre d’un nombre restreint d’émetteurs. Pour contourner ce problème, les gestionnaires font normalement appel aux parts de fiducies de revenu et aux obligations de sociétés (corporate bonds).
Jusqu’à tout récemment, les fonds de dividendes fortement investis dans les fiducies de revenu brillaient avec éclat. Étant donné l’avantage fiscal dont jouissent ces fiducies, tous les projecteurs étaient tournés vers elles. Seulement voilà, le gouvernement fédéral a modifié les règles fiscales en novembre 2006 de manière à ce que l’imposition des distributions des fiducies de revenu devienne semblable à celle des dividendes d’ici la fin de 2011. Cette décision, visant à décourager les sociétés ouvertes de se convertir en fiducies de revenu, n’a pas manqué de jeter une douche froide sur la valeur de ces unités et sur le rendement des fonds qui y sont exposés.
Au reste, les obligations d’entreprises constituent le placement le moins avantageux à l’extérieur du REER, car les revenus d’intérêt sont imposables à 100 %. Il faut noter que les obligations ont tout de même l’avantage d’accroître la stabilité du fonds, tout comme les actions privilégiées.
En comprenant mieux les fonds de dividendes, un investisseur peut donc maximiser les avantages qu’il en tire. Il faut aussi noter que les fonds de revenu mensuel, parfois aussi appelés fonds diversifiés, ont fait leur apparition depuis quelques années et sont composés des quatre mêmes classes d’actifs. Ils méritent aussi notre attention.
Dans la chronique du mois dernier, nous avons abordé les plus récentes modifications apportées au régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Même si le gouvernement fédéral n’a pas jugé bon de hausser la limite à vie de la subvention de 7 200 $ à laquelle un bénéficiaire a droit, le régime a été bonifié, car la subvention est dorénavant accordée sur les premiers 2 500 $ de capital investi par enfant, comparativement à 2 000 $ avant le 1er janvier 2007. La subvention annuelle passe ainsi de 400 $ à 500 $. De plus, le gouvernement du Québec ajoute dorénavant une subvention de 250 $ pour toute cotisation annuelle de 2 500 $.
Les autres améliorations apportées au régime sont :
- l’abolition de la limite de cotisation annuelle de 4 000 $;
- l’augmentation de la limite de cotisation à vie, de 42 000 $ à 50 000 $.
Ces deux éléments peuvent modifier d’une manière significative la façon d’accumuler de l’épargne pour les études des enfants.
En effet, dorénavant, des parents ou des grands-parents peuvent, à la naissance de leur enfant ou petit enfant, cotiser d’un seul coup jusqu’à 50 000 $ dans un REEE. Ce faisant, ils peuvent toucher une seule subvention, tout en faisant croître longtemps les revenus à l’abri de l’impôt.
En pratique, une cotisation de 50 000 $ dans un REEE pourrait croître jusqu’à 183 358 $1après 18 ans, comparativement à 116 447 $2 dans un compte non enregistré. L’écart de 66 911 $ provient presque exclusivement du fait que, dans le REEE, les rendements profitent à l’abri de l’impôt.
Par contre, si un souscripteur investissait plutôt 2 500 $ par année dans un REEE afin de toucher toutes les subventions auxquelles il aurait droit, tout en laissant le reste de son capital de 50 000 $ croître dans un compte non enregistré, son portefeuille (REEE et non enregistré) atteindrait 164 981 $2.

De fait, le scénario idéal se situe entre les deux précédents, car il est préférable de placer rapidement un bon montant à l’abri de l’impôt (même si l’on se prive des subventions gouvernementals futures). Voici un exemple :
- cotiser 30 000 $ à un REEE la première année; et
- placer 20 000 $ dans un compte non enregistré, duquel serait retiré annuellement un montant de 2 500 $ qui serait transféré au REEE, pendant une période de 8 ans.
En agissant ainsi, vous toucherez seulement 6 750 $ de subventions (500 $ X 9 et 250 $ X 9) alors que le maximum est 10 800 $ (7 200 $ au fédéral et 3 600 $ au provincial). Cependant, le portefeuille accumulé atteindra 189 647 $.
1 Rendement projeté de 7 %
2 Rendement projeté de 7 % et taux moyen d’imposition des rendements de 35 %
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet de faire fructifier des épargnes, à l’abri de l’impôt, jusqu’à ce que l’enfant que l’on veut aider (le bénéficiaire) s’inscrive à un programme d’études postsecondaires.
Pour encourager les contribuables à économiser, le gouvernement du Canada verse une subvention (la Subvention canadienne pour l’épargne-études ou SCEE), directement dans le REEE dont l’enfant est bénéficiaire.
Dans son dernier budget, le gouvernement du Canada a adopté des mesures destinées à« rehausser l’attrait des REEE », soit :
- l’élimination du plafond des cotisations annuelles de 4 000 $;
- l’augmentation du plafond cumulatif des cotisations de 42 000 $ à 50 000 $;
- la hausse du montant maximal annuel de la Subvention canadienne pour l’épargne-études de 400 $ à 500 $.
En pratique, ces trois mesures signifient que :
- la cotisation maximale de 4 000 $, par année et par bénéficiaire, n’existe plus;
- pour toute la durée du régime, la limite cumulative des cotisations est désormais de 50 000 $;
- la subvention de 20 % s’applique dorénavant à la première tranche de 2 500 $ des cotisations annuelles, pour un total de 500 $.
Il est à noter :
- que le plafond cumulatif de subvention au régime (7 200 $ au total, par bénéficiaire) demeure le même; en conséquence, quatorze cotisations de 2 500 $ et une quinzième cotisation de 1 000 $ permettront d’atteindre ce montant limite (14 x 500 $ + 1 x 200 $ = 7 200$);
- qu’il est toujours possible de récupérer une année de retard de subvention à la fois. Ainsi, une cotisation de 5 000 $ permettra d’obtenir 1 000 $ de subvention, si l’enfant n’a pas touché toutes les subventions auxquelles il a droit depuis sa naissance.
Le paiement d’aide aux études (PAE)
Le paiement d’aide aux études (PAE) est un montant qui provient d’un REEE et qui est versé pour aider un bénéficiaire à payer le coût de ses études postsecondaires. Constitué des subventions et des revenus accumulés au fil des ans, ce paiement ne comprend pas les cotisations du souscripteur.
Pour un étudiant à temps plein, le PAE est limité à 5 000 $ pour la première session de cégep alors qu’il est sans limite par la suite.
Depuis le dernier budget fédéral, un étudiant à temps partiel peut aussi recevoir un PAE, qui est toutefois limité à 2 500 $ par session.
| |
AVANT
le 1er janvier 2007 |
APRÈS
le 1er janvier 2007 |
| Plafond de la cotisation (par année) |
4 000 $ |
Aucun |
| Plafond de la cotisation (à vie) |
42 000 $ |
50 000 $ |
| Plafond de la subvention (à vie) |
7 200 $ |
7 200 $ |
Limite de la subvention annuelle
(en l’absence de retard) |
400 $
(20 % de 2 000 $) |
500 $
(20 % de 2 500 $) |
Limite de la subvention annuelle
(en cas de retard) |
800 $
(20 % de 4 000 $) |
1 000 $
(20 % de 5 000 $) |
| Admissibilité aux PAE |
Étudiants
à temps plein
seulement |
Étudiants
à temps plein
ou à temps partiel(certaines restrictions s’appliquent) |
|
Subvention du gouvernement du Québec
Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il ajoutera 10 % sur les premiers 2 500 $ cotisés annuellement dans ce régime.
Dans la prochaine chronique, nous verrons comment l’abolition de la limite de la cotisation annuelle de même que l’augmentation de la limite de cotisation à vie pourront influencer positivement le régime.
Les marchés boursiers ne sont pas pour les âmes sensibles…
À la Bourse, les gens constatent, souvent avec un brin d’ironie, qu’ils peuvent acheter une action seulement si quelqu’un est prêt à vendre. Autrement dit, la transaction n’est possible que si deux opinions contraires se rencontrent. Ainsi, pendant que l’analyse des uns les pousse à choisir un titre, l’analyse des autres doit les inciter à s’en départir.
Comment expliquer cette contradiction ? Simplement par le fait qu’il n’existe pas de recette magique ou de formule toute faite pouvant nous aider à savoir quand acheter un titre boursier. C’est toujours du cas par cas. Et il ne faut surtout pas se fier aux apparences, mais plutôt gratter en profondeur.
Dans ce contexte, la meilleure façon de rester au-dessus de la mêlée est de voir venir les choses. Voilà pourquoi les analystes scrutent les données financières des entreprises, et tout le tralala, afin de déterminer la valeur des actions.
Mais ce n’est pas une mince affaire. Prenons, par exemple, le ratio cours/bénéfice (C/B). Facile à calculer, ce ratio s’obtient en divisant le cours d’une action ordinaire par le bénéfice par action de l’entreprise. Ainsi, si le titre se négocie à 30 $ et le bénéfice par action est de 1 $, le ratio cours/bénéfice sera de 30. En théorie, plus ce multiple est bas, plus l’action ordinaire est une aubaine. Mais, dans les faits, cette analyse est un peu plus complexe.
Préciser le point de chute
Pour déterminer si une action est chère ou non, il faut un point de repère. De ce raisonnement logique découle le concept de la juste valeur marchande, qu’on définit comme étant le prix le plus élevé qu’il serait raisonnable d’attendre pour vendre une action, suivant la méthode habituellement applicable et le cours normal des affaires, sur un marché qui n’est pas soumis à des tensions indues.
En ayant à l’esprit cette définition, cette juste valeur nécessitera-t-elle un ratio C/B de 10 ou de 25 ? La réponse varie d’un secteur d’activité à l’autre. Par exemple, dans l’alimentation, où les marges de profit sont réduites, la réduction des coûts améliorera la valeur d’une entreprise. Dans les biotechnologies, on s’intéressera aux efforts de recherche et développement.
Normalement, une entreprise cyclique sera affublée d’un ratio C/B plus faible (surtout quand les profits atteignent un sommet). À l’inverse, une entreprise qui entraîne beaucoup de liquidités et qui est en forte croissance (ex.: eBay et Google) méritera un ratio C/B plus élevé.
L’investisseur doit donc acheter en toute connaissance de cause, et faire preuve de jugement. Il doit comprendre la nature intrinsèque de l’entreprise évaluée et avoir une idée de ses perspectives à long terme (cinq ans et plus). Il doit donc se méfier du bénéfice déclaré, car ce dernier ne reflète pas tout le temps la réalité. Ce chiffre ne doit absolument pas être pris à la lettre, mais plutôt être décortiqué afin de déterminer la réelle capacité bénéficiaire des entreprises. Par exemple, les dépenses extraordinaires peuvent réduire le bénéfice d’un trimestre donné, bien qu’elles risquent fort de ne pas se répéter dans l’avenir.
Considérer le taux sans risque
Un autre élément qu’il faut absolument prendre en compte est l’environnement qui prévaut lors de l’achat. Intuitivement, avant de prendre un risque, il est toujours préférable de considérer le gain que l’on peut faire sans se mouiller.
Prenons, par exemple, le ratio cours/bénéfice de l’indice S&P/TSX qui était de 16,65 en avril 2007. Selon le modèle de la Fed, popularisé en 1997, ce ratio équivaut à un taux d’intérêt de 6 % (1/16,65 x 100), un résultat nettement supérieur au rendement des titres à revenu fixe, soit 4,16 % (obligations canadiennes de 5 à10 ans) au même moment. Ce résultat indique clairement que la Bourse peut encore s’apprécier.
Le même raisonnement s’applique aux titres individuels, avec la différence que le taux de croissance du bénéfice peut influencer la juste valeur de l’action. Il est donc important de déterminer si l’entreprise progresse plus ou moins rapidement que l’ensemble du marché. Celle-ci méritera un multiple plus élevé si son rythme de croisière est plus rapide que celui des autres entreprises.
En reprenant l’exemple précédent, il est possible d’évaluer que le multiple maximal du marché canadien serait de 24 (1/24 x 100 = 4,16 %) dans l’environnement actuel. Sachant que la croissance boursière historique de ce marché tourne autour de 8 %, on pourrait très bien tolérer un multiple plus élevé lorsque le bénéfice d’une entreprise croît à 16 %. Logiquement, si un multiple de 24 est acceptable avec une perspective de croissance de 8 %, un multiple de 48 pourrait très bien s’appliquer à un taux de 24 %.
Bien entendu, dès qu’il y a un changement dans la direction des taux à long terme ou de la croissance de l’entreprise, cette analyse prend une autre dimension. Afin de se protéger contre ce risque, il est toujours préférable de calculer une marge de sécurité. C’est pourquoi un multiple de 17 sera préférable à 24, malgré les taux d’intérêt actuels. Et ce multiple permettra de déterminer la juste valeur des entreprises.
Savoir si le passé a de l’avenir
Dans la pratique, on constate que même en analysant en profondeur le ratio cours/bénéfice, il est souvent difficile de faire un choix précis. Certains investisseurs, par exemple, sélectionneront les titres sur la base de leur valeur passée selon le concept de retour à la moyenne. Ils observeront la performance relative historique d’un titre par rapport au marché afin de connaître la direction qu’il prendra. En termes simples, ils tenteront de dénicher des titres qui se négocient en dessous de leur valeur moyenne historique dans l’espoir que ceux-ci reviendront à leur juste valeur.
D’autres investisseurs estiment qu’il ne faut pas seulement se fier au passé et s’intéressent à l’évolution future de l’entreprise. Ainsi, une baisse soudaine du ratio C/B d’une entreprise en bonne santé financière peut indiquer que le marché s’attend à une détérioration de son bilan prochainement. À l’inverse, un multiple subitement plus élevé peut dénoter qu’une hausse du bénéfice déclaré est attendue. Il est cependant important de comprendre que la croissance anticipée du bénéfice n’est qu’une hypothèse.
Bref, personne n’a la science infuse. Mais, une chose est certaine, pour être en position de force dans le marché boursier, un investisseur doit être capable de déterminer si le prix d’une action est raisonnable ou non.
Évolution du ratio cours/bénéfice du marché boursier canadien (S&P/TSX)
| Période |
Ratio C/B |
| 1960-69 |
17,4 |
| 1970-79 |
11,6 |
| 1980-89 |
14,3 |
| 1990-97 |
42,9 |
| Juin 2000 |
30 |
| Avril 2007 |
16,65 |
|
Source : OCDE, Bloomberg et Bourse de Toronto
Article de Monsieur Claude Picher paru le 12 septembre 2006 dans La Presse, section Affaires, sous-section La vie économique. Reproduction autorisée, Tous droits réservés.
Nouveau record pour la liberté économique
Partout sur la planète, la liberté économique a fait des progrès spectaculaires au cours des deux dernières décennies. En fait, depuis 1980, la liberté économique a progressé dans tous les pays du monde sauf quatre (Birmanie, Congo, Venezuela et Zimbabwe). On peut donc affirmer que jamais, dans l’histoire de l’humanité, le niveau de liberté économique n’a été aussi élevé.
C’est ce qu’indique le plus récent relevé annuel sur la question, publié simultanément la semaine dernière par 72 organismes de recherche économique dans le monde. Au Canada, c’est l’Institut Fraser qui est responsable de la publication 1.
La liberté économique correspond à la facilité, pour les particuliers et les entreprises, d’investir et de profiter de leurs rendements avec un minimum de contraintes.
Les auteurs du document mesurent le niveau de liberté économique de 130 pays, selon une grille comportant 38 critères: entraves bureaucratiques, intégrité du système judiciaire et impartialité des tribunaux, solidité du système financier, taux d’inflation, convertibilité des monnaies, tarifs douaniers et barrières non tarifaires, contraintes bureaucratiques, solidité des institutions financières, protection de la propriété intellectuelle, poids de l’État dans l’économie, entre autres.
Le tout est ensuite reporté sur une échelle de 1 à 10. Plus le score est élevé, plus le niveau de liberté économique l’est aussi.
Le classement publié la semaine dernière fournit les chiffres de 2004, dernière année pour laquelle toutes les données sont disponibles.
Le Canada, avec une huitième place, fait partie du peloton de tête. En soi, ce n’est pas une grande nouvelle. Année après année, le Canada se classe parmi les 10 pays où la liberté économique est la plus avancée. Ainsi, l’an dernier, il se classait au sixième rang, l’année d’avant, au septième, 20 ans plus tôt, au neuvième.
Plutôt que le rang au classement général, il faut surtout considérer le pointage, sur l’échelle de 1 à 10 dont nous venons de parler. Aucun pays ne parvient à afficher un score parfait de 10. La première place revient à Hong Kong (considéré pour les fins de l’étude comme une entité séparée de la Chine), avec une note de 8,7 points. Le Canada, avec huit points, s’en tire fort honorablement, d’autant plus qu’il n’obtenait que sept points il y a 20 ans. Si son rang au classement ne bouge pas beaucoup malgré l’amélioration de son score, c’est que le niveau de liberté économique augmente aussi ailleurs dans le monde. Ce que ces chiffres nous disent, c’est que le Canada est capable de s’adapter aux changements, et qu’il demeure un concurrent sérieux sur la scène internationale.
Outre Hong Kong et le Canada, les 10 pays offrant le plus de liberté économique sont Singapour, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les États-Unis, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Islande et le Luxembourg. À l’inverse, les pires pays sont le Rwanda, le Burundi, l’Algérie, la Guinée-Bissau, le Venezuela, les deux Congos, la Birmanie et le Zimbabwe.
L’étude ne fournit pas de chiffres pour les administrations subalternes, comme les États américains ou les provinces canadiennes, pour la bonne raison que de nombreux critères, comme les tarifs douaniers ou la politique monétaire, relèvent des administrations centrales. Comme le Québec est plus taxé et plus bureaucratisé que les autres provinces, on peut raisonnablement présumer que le niveau de liberté économique y est sensiblement inférieur à la moyenne canadienne.
Comme la notion de liberté économique suppose l’élimination des contraintes, on pourrait penser que plus son niveau est élevé, plus on s’approche du capitalisme sauvage.
Sur papier, l’idée se défend: la liberté économique absolue signifie l’élimination des administrations publiques. Dans la vraie vie, c’est une tout autre histoire, parce que les gouvernements, même s’ils interviennent moins dans l’économie, continuent de jouer leur rôle d’encadrement et de réglementation, de construire des infrastructures, d’administrer des programmes sociaux, de fournir des services de sécurité, de santé, d’éducation, entre autres. Évidemment, plus une société est prospère, plus elle peut s’offrir des services publics de qualité.
Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’oeil sur les principaux indicateurs de niveau de vie pour voir que celui-ci augmente avec le niveau de liberté économique.
Dans les pays où il existe le plus de contraintes économiques, 19,3 % des enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent à l’extérieur, souvent dans des conditions misérables; dans les pays où la liberté économique est la plus avancée, cette proportion baisse à 0,3 %.
L’espérance de vie à la naissance est de 55 ans dans les pays où il y a peu de liberté économique, comparativement à 78 ans dans les pays où il y en a beaucoup. Le taux de mortalité infantile est de 72,4 décès pour 1000 naissances dans le premier cas, de 5,9 dans le deuxième.
La liberté économique ne signifie pas la liberté de polluer. Deux organismes reconnus, le Center for Environmental Law & Policy, rattaché à l’Université Yale, et le Center for International Earth Science Information Network, rattaché à l’Université Columbia, ont mis sur pied un indice de » performance environnementale « , où chaque pays reçoit une note (sur un total possible de 100) mesurant l’efficacité de sa lutte contre la pollution. Plus la note est élevée, mieux c’est. Les pays offrant le plus de liberté économique récoltent 81 %; ceux où la liberté économique est la moins avancée ne font que 58 %.
De la même façon, le niveau de corruption, tel que mesuré par Transparence International, diminue en même temps que la liberté économique augmente.
On pourrait multiplier les exemples. Ainsi, sur le plan économique, il n’est pas exagéré de parler de fossé. Le revenu par habitant, dans les pays où il existe peu de contraintes économiques, se situe à 24 402 $US par année. Dans les pays où les contraintes sont les plus élevées, il atteint seulement 2998 $US. Ces deux montants sont exprimés en parité de pouvoir d’achat.
Entre 1990 et 2003, le revenu réel par habitant a augmenté en moyenne de 2,1 % par année dans les pays les plus libres, et il a régressé de 0,2 % par année dans les pays les plus contraignants. Enfin, le taux de chômage se situe à 5,9 % dans le premier groupe et à 12,7 % dans le deuxième.
Tous ces chiffres nous amènent assez loin du capitalisme sauvage !
On parle beaucoup de l’augmentation de la demande fondamentale de pétrole, en rappelant l’explosion de la demande chinoise et l’épuisement éventuel des ressources pétrolières.
Comment comprendre la montée fulgurante du prix du pétrole au cours des cinq dernières années? Et cette récente tendance, est-elle un bon indicateur pour extrapoler la trajectoire future des prix?
Avant de faire une prévision des prix futurs, il faut remettre en contexte les causes de l’augmentation de la demande, l’incertitude de la déstabilisation du système d’exploitation et d’acheminement du pétrole et la spéculation de la part des investisseurs financiers.
LE JEU DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Manque d’exploration et d’investissement durant les années 1990.
À la suite du choc pétrolier de la fin des années 1970, le prix du baril oscillait autour de 40 $. Le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI), un indice pétrolier de référence important, est retombé dans une fourchette de 10 à 30 dollars américains le baril durant la période de 1985 à 2002. Au cours de cette période, l’industrie pétrolière jugeait que les réserves pétrolières et l’infrastructure d’extraction et de raffinage étaient suffisantes pour répondre à la demande anticipée. Le prix de revente du pétrole ne justifiait donc pas de programme d’expansion additionnel important.

Crise asiatique de 1998-1999.
Le graphique ci-contre illustre l’évolution de l’excédent de l’offre de pétrole au-delà de la demande (ligne pleine « Capacité excédentaire de production) par rapport au prix du pétrole ligne pointillée « Prix du pétrole WTI.
En 1998 et 1999, la crise asiatique survient et la demande mondiale de pétrole ralentit par rapport à l’offre. On observe alors un accroissement important de la capacité excédentaire de production de pétrole, ce qui a fait fléchir le prix du pétrole autour de 10 dollars américains pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande.
Boom de l’an 2000 et miracle de productivité.
Avec l’accélération économique mondiale qui a suivi l’an 2000 en raison de politiques monétaires expansionnistes et d’un boom d’investissements pour contrer le bogue de l’an 2000 et pour déployer une nouvelle infrastructure informatique, la demande de pétrole a augmenté rapidement, la capacité excédentaire de production de pétrole s’est affaissée et le prix du pétrole a subi une hausse pour atteindre 30 dollars américains.
Récession mondiale en 2001.
Dans le contexte de la récession de 2001-2002, auquel s’ajoutait une montée des incertitudes géopolitiques due à l’attentat terroriste en sol américain, plusieurs économistes prévoyaient un environnement économique difficile pendant une longue période au cours de laquelle les entreprises hésiteraient à investir et à créer des emplois. À leur tour, les consommateurs hésiteraient à dépenser. Le graphique illustre ainsi la vive remontée de la capacité excédentaire de production de pétrole et la chute des prix du pétrole.
Reprise économique fulgurante en 2003.
À la suite des politiques financières et fiscales vigoureuses et concertées, l’économie mondiale a bondi à partir de 2003, et la demande de pétrole a suivi.
Comme l’offre de pétrole n’a pu s’ajuster rapidement (exploration, construction de raffineries, pipelines, etc. étant au ralenti depuis plus d’une décennie), le prix demeure la variable d’ajustement permettant de concilier l’offre et la demande. Il a donc subi une vive ascension.
Nouveaux facteurs d’amplification.
Plusieurs nouveaux facteurs sont venus composer l’effet cyclique de la demande sur le prix du pétrole.
- Incertitudes géopolitiques. Une suite d’événements géopolitiques sont survenus pour mettre en doute la capacité d’acheminement de pétrole : l’invasion de l’Irak en 2003, des attentats terroristes sur des pipelines, l’expropriation des activités de production de Yukos en Russie, les pressions politiques internes au Venezuela et au Nigeria, les ouragans aux États-Unis, la menace de rivalités à la suite du programme nucléaire iranien, etc. Tous ces éléments font craindre un risque d’interruption dans l’approvisionnement en pétrole. Et parce qu’il est difficile d’interrompre les activités de production d’une raffinerie de pétrole à cause des risques de bris mécaniques, les raffineries se sont mises à se constituer des réserves de pétrole brut afin d’éviter une pénurie éventuelle.
- La Chine : On parle beaucoup de l’émergence de la Chine sur le plan économique mondiale et de l’augmentation rapide de sa consommation de pétrole en raison de la modernisation de son économie. Il faut cependant préciser que ce développement à long terme ne saurait expliquer à lui seul l’explosion de la demande chinoise à court terme.Le processus mondial de sous-traitance internationale (offshoring), où la capacité de production manufacturière mondiale est progressivement relocalisée dans les pays où les coûts de production sont inférieurs, y est aussi pour quelque chose. Ainsi, au cours des quelques dernières années, la chine a augmenté ses dépenses en capital à un rythme annuel effréné de plus de 30 % en 2003 et 2004, et à près de 25 % en 2005 et 2006 dans le but de s’outiller suffisamment (usines, infrastructure urbaine, de transport, etc.), afin de subvenir à la demande mondiale. Cette situation a créé une demande-choc pour l’acier, le béton, le cuivre, la machinerie lourde, les services de transports maritimes et le pétrole.Ce soubresaut de demande chinoise pour le pétrole ne reflète donc pas seulement l’accroissement de la demande domestique, mais aussi beaucoup la relocalisation en cours de la plateforme de production manufacturière mondiale.
- Investisseurs financiers. Observant l’appréciation du pétrole et des denrées en général et projetant un accroissement de la demande de pétrole et de l’incertitude géopolitique, les spéculateurs sont entrés en force et ont établi des positions record dans les marchés à terme du pétrole. Ces derniers sont habituellement dominés par les acheteurs et vendeurs industriels. Cette nouvelle source de demande de pétrole a été suivie par des investisseurs institutionnels, tels les caisses de retraite, qui ensemble ont injecté des milliards de dollars pour établir des positions à long terme dans des fonds de denrées.Le prix du pétrole reflète donc aujourd’hui aussi un élan d’enthousiasme ayant son origine dans des positions spéculatives importantes et dans un rajustement récent de portefeuille.
Pour revenir au graphique précédent, on peut donc expliquer pourquoi la capacité excédentaire de production de pétrole est demeurée si dangereusement basse entre les années 2003 et 2006, et pourquoi le prix du pétrole a connu une progression, pour ainsi dire, unidirectionnelle.
À mi-cycle en 2007.
Aujourd’hui, on commence à observer les conséquences d’une période prolongée de prix de pétrole élevés : pleine utilisation de la capacité de production, accélération des activités d’exploration et de construction d’usines de raffinage, rentabilité des projets où l’extraction est plus coûteuse (sables bitumineux canadiens), utilisation de l’éthanol, subventions pour les véhicules hybrides, réduction de l’utilisation des véhicules par certains usagers, rétablissement de la production iraquienne et modération du rythme de croissance économique global à la suite dubond fulgurant de la relance économique.
On remarque ainsi sur le graphique qu’au cours des douze derniers mois, il y a une augmentation marquée de la capacité excédentaire de production de pétrole. Même les inventaires de pétrole augmentent substantiellement tout au long de la chaîne de distribution. Assistons-nous présentement à une montée vers un sommet du prix du pétrole?
La conclusion semble assez claire. En effet, l’augmentation du prix du pétrole depuis 2003 est principalement due à la reprise économique mondiale. Cette montée du prix a profité d’une prime d’incertitude géopolitique qui tarde à s’atténuer et d’une prime spéculative de la part d’investisseurs financiers.
Sous un scénario d’une modération de l’économie mondiale à mi-cycle par rapport au rythme effréné des années précédentes, le prix du pétrole pourrait ainsi demeuré essentiellement stable au cours des cinq prochaines années, tandis que l’accroissement continu de la demande fondamentale remplacera progressivement la dissipation des primes d’incertitude et de spéculation.
Par contre, dans un scénario de ralentissement économique mondial important, on doit s’attendre à une correction majeure du prix du pétrole, car la pression de vente des positions des investisseurs financiers sur le prix du pétrole s’ajouterait à la réduction de la demande.
Le prix du pétrole reflète aujourd’hui l’ensemble des incertitudes et de la spéculation. Pour que le prix du pétrole puisse continuer d’augmenter, il ne faut pas simplement un maintien de l’environnement politico économique, mais de nouvelles sources de demande ou de nouvelles sources d’incertitude.
Parmi les nombreux articles de nature économique et financière publiés chaque année, certains s’avèrent particulièrement intéressants. Dans le texte qui suit, vous pourrez apprécier un article de M. Claude Picher, publié le 22 août 2006, dans la section Affaires de LA PRESSE.
TPS: l’erreur de Harper
L’ex-ministre libéral John McCallum, critique de l’opposition en matière de finances, vient de confirmer que son parti s’oppose à toute nouvelle baisse du taux de la TPS.
C’est une position qui risque de choquer les consommateurs. La TPS a été établie par le gouvernement de Brian Mulroney en 1991, au taux de 7 %. Elle remplaçait l’ancienne taxe de 13,5 % imposée sur les produits manufacturés, et qui était camouflée dans le prix de vente. Les électeurs canadiens ont très mal digéré la nouvelle taxe. On peut certainement penser que la déroute des conservateurs, en 1993, est due en bonne partie à l’impopularité de la TPS, d’autant plus que les libéraux de Jean Chrétien avaient promis de l’abolir. Une fois au pouvoir, ils s’en sont bien gardés, pour une raison assez simple: la TPS rapporte 30 milliards par année. Si on la supprime, on la remplace par quoi? Toujours est-il que les libéraux ne rempliront jamais leur promesse.
En revanche, les conservateurs de Stephen Harper ont promis de baisser le taux de la taxe à 6 % dès leur arrivée au pouvoir, et à 5 % à l’intérieur de leur mandat de quatre ans, s’ils parviennent à durer aussi longtemps. Contrairement aux libéraux, ils ont rapidement rempli la première partie de leur promesse.
M. McCallum ne tient pas à rétablir le taux de 7 % si son parti reprend le pouvoir, mais avertit les consommateurs qu’il n’est pas question de l’abaisser à 5 %.
Certes, la feuille de route des libéraux, dans ce dossier, est aussi incohérente que vaporeuse: après avoir patiné pendant des mois, ils ont fini par carrément renier leur promesse.
Malgré cela, M. McCallum a raison. La baisse de la TPS d’un point de pourcentage, qui coûte cinq milliards par année à Ottawa, est une erreur. Et on ne ferait qu’empirer la situation en la réduisant davantage.
Partout dans le monde, les administrations publiques tendent de plus en plus à taxer la consommation plutôt que le revenu.
Les taxes à la consommation, comme la TPS, s’appliquent directement à votre niveau de vie. Vous vous payez une Mercedes S550 à 118 000 $? Vous paierez 7100 $ de TPS (plus 9400 $ de taxe provinciale). Tant mieux si vous en avez les moyens. Mais si vous achetez une Honda Civic à 24 000 $, vous ne paierez que 1400 $ de taxe fédérale et 1900 $ de taxe provinciale. Grosse voiture, grosses taxes.
Or, le même raisonnement ne s’applique pas pour les impôts sur le revenu. Certes, la progressivité du régime fiscal fait en sorte que plus votre revenu augmente, plus vous grimpez dans les fourchettes d’imposition. Ainsi, si votre revenu imposable est de 25 000 $, votre taux d’imposition, au fédéral comme au provincial, est de 16 %. Mais si votre revenu imposable est de 250 000 $, ces taux passent à 29 % et 24 % respectivement. Toutes proportions gardées, les riches paient donc plus d’impôts sur leur revenu imposable. Or, les contribuables à revenus élevés disposent généralement d’une plus grande marge de manoeuvre pour réduire leur revenu imposable.
Avec un revenu de 25 000 $, il ne vous reste pas grand-chose pour contribuer à un REER, investir sur le marché boursier, déclarer des dividendes ou réaliser des gains en capital.
D’autre part, l’impôt sur le revenu est une des meilleures façons de décourager les gens de travailler. Plus vous travaillez, plus vos revenus augmentent, plus vous progressez dans les fourchettes d’imposition, plus vous payez d’impôts.
Ce problème ne se pose pas avec les taxes à la consommation: plus vous dépensez (et donc, présumément, plus vous êtes riche), plus vous payez de taxes sur vos achats. Même le mafioso qui se paie un repas de grand luxe au restaurant doit payer sa TPS et sa TVQ.
Certes, les taxes à la consommation sont, par définition, régressives, c’est-à-dire qu’elles défavorisent les consommateurs à faibles revenus. Vous achetez une chemise à 60 $? Vous paierez exactement le même montant de taxe, que vous gagniez 200 000 $ ou 20 000 $ par année. Toutefois, cet obstacle peut facilement être contourné avec des crédits d’impôt à l’intention des ménages à faibles revenus.
L’impôt sur le revenu comporte une foule d’échappatoires. Il est lourd et coûteux à administrer. Il décourage le travail et contribue à freiner les gains de productivité. En revanche, les taxes à la consommation sont faciles à appliquer et contribuent à diminuer l’évasion fiscale.
Dans ces conditions, on comprend que la majorité des pays, partout dans le monde, se dirigent vers un régime fiscal où on taxe de plus en plus la consommation, et de moins en moins les revenus. Les taxes à la consommation représentent la principale source de revenus fiscaux dans 21 des 30 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui regroupe pour l’essentiel des pays industrialisés.
Le Canada est un des neuf pays où l’impôt sur le revenu des particuliers demeure la principale source de revenus. L’impôt sur le revenu des particuliers représente 35 % des revenus fiscaux du Canada, contre une moyenne de 26 % dans les pays de l’OCDE. Les chiffres correspondants, pour les taxes à la consommation, sont de 26 % et 32 %.
Ces données sont les plus récentes disponibles, mais elles datent de trois ans. On peut avancer sans aucun doute que l’écart entre le Canada et les autres pays industrialisés a continué de se creuser depuis, surtout avec la baisse de la TPS. Autrement dit, Stephen Harper, avec ses baisses de TPS, nage clairement à contre-courant de ce qui se fait ailleurs.
En ce sens, les libéraux, en disant qu’ils maintiendraient la TPS à 6 %, ne gagneront probablement pas de concours de popularité, mais sur le fond de la question, il est clair que leur position est plus sensée.
- Petite capitalisation
- Grande capitalisation
- Style valeur
- Style croissance
- Un peu de chacune
- Aucune de ces réponses
Les marchés boursiers sont composés de titres variés que l’on regroupe par caractéristiques principales pour analyser les facteurs les plus influents sur leur rendement. Ainsi, il y a d’une part les titres dits de petite capitalisation (car la valeur de l’entreprise est plus petite) que l’on compare aux titres de grande capitalisation, et d’autre part les titres de style valeur (dont l’entreprise est plus mature, les revenus et dividendes sont plus stables et dont les cours en bourse sont moins volatils) que l’on compare aux titres de style croissance.
Les experts recommandent de plus en plus d’investir dans les titres de petite capitalisation et dans ceux de style valeur. Ces idées d’investissement gagnent en popularité du fait que ces titres affichent de meilleurs rendements que les titres comparables depuis plus de cinq années consécutives.

La figure 1 illustre le rendement relatif des titres de petite capitalisation, représentés par l’indice des titres américains S&P 600, relativement aux 5 000 titres les plus importants du marché américain, représentés par l’indice Wilshire 5000. Lorsque la ligne du graphique est haussière, comme c’était le cas dans la période de 1999 à 2006, un investisseur obtient de meilleurs rendements en détenant des titres de petite capitalisation plutôt que de l’ensemble du marché boursier.
La figure 1 met d’abord en évidence que, depuis plus de 25 ans, les titres de petite capitalisation offrent essentiellement le même rendement que ceux e l’ensemble du marché boursier, bien que l’on retrouve des cycles à l’intérieur de cette longue période où les rendements diffèrent substantiellement.
Ensuite, on remarque que les titres de petite capitalisation devancent substantiellement leur contrepartie au cours des années qui suivent le creux des récessions. Sur le graphique, la courbe est fortement haussière après 1980, 1990 et 2001.
La raison de l’excellente performance des titres de petite capitalisation durant ces périodes tient d’abord du fait que ce sont, par définition, des titres plus volatils, de compagnies moins matures, dont le plan d’affaires et les revenus reposent sur la commercialisation de biens et services moins diversifiés, dans des marchés plus restreints et dont le bilan est relativement plus faible.
Donc, lorsque la fin d’un cycle économique se transforme en récession, les titres de petite capitalisation sont les plus durement touchés. Par conséquent, lorsque les banques centrales abaissent leurs taux d’intérêt de manière expansionniste pour relancer les économies, que la demande reprend et que les investisseurs reprennent goût au risque, les titres les plus sensibles à la relance économique sont ces mêmes titres de petite capitalisation.
Cependant, cinq années ont maintenant passé depuis la dernière récession et, suivant le succès de la relance économique mondiale, les banques centrales ont ajusté leur politique monétaire de vivement expansionniste à plutôt neutre. Donc, pendant que le rythme de croissance économique mondial ralentit en s’ajustant à ces nouvelles conditions monétaires, que l’accès au capital devient plus onéreux et difficile pour les entreprises moins bien assises, ce sont les titres de grande capitalisation qui commencent à afficher des rendements relatifs supérieurs.
Les grandes entreprises sont comparativement moins sensibles au coût et à la réduction que la quantité de capital disponible, et leur plus grande diversification commerciale et étendue géographique leur permettent de mieux assurer la progression de leur chiffre d’affaires.
L’essentiel n’est donc pas de savoir si les titres de petite capitalisation constituent un meilleur ou un pire investissement que ceux de l’ensemble du marché boursier, mais plutôt de reconnaître que leur attrait dépend du prix que l’on paie pour les acheter. Et il semble que de nos jours, les titres de petite capitalisation sont à un extrême de valorisation par rapport à leur vis-à-vis depuis vingt-cinq ans. Ainsi, la probabilité d’afficher de meilleurs rendements au cours des deux ou trois prochaines années favorise les titres de grande capitalisation.
On observe aussi aujourd’hui d’ailleurs un extrême de valorisation entre les titres de style valeur par rapport à ceux de style croissance.

La figure 2 suggère de nouveau que sur les 25 dernières années, les investisseurs défensifs détenant des titres de style valeur et les investisseurs agressifs avec des titres de croissance, ont obtenu essentiellement le même rendement.
Durant la période de 1998 à 2000, les personnes et les entreprises ont accéléré l’adoption d’Internet dans leurs pratiques commerciales, beaucoup d’investissements ont eu lieu en prévoyance du bogue de l’an 2000, mais surtout plusieurs disaient alors qu’il y avait un miracle de productivité, que l’on avait battu l’inflation et le caractère cyclique de l’économie. Tous préféraient les titres de croissance et on peut clairement voir l’appréciation de ces titres par rapport à ceux de style valeur sur le graphique.
Depuis, il y a eu la récession américaine, l’éclatement de la bulle spéculative des titres de technologie, les scandales financiers, les attentats terroristes. Tous les événements ont fait croire à bien des économistes que les entreprises seraient bien hésitantes à créer de l’emploi et à investir, que la relance serait difficile à engendrer et qu’il y avait même un risque sérieux de baisse généralisée des prix à la consommation (déflation).
Dans un tel contexte, qui voudrait investir dans des entreprises qui réinvestissent leur précieux capital pour mettre au point de nouveaux produits ou marchés? Les investisseurs étaient clairs : ils privilégiaient les sociétés qui retournaient de préférence leurs profits aux actionnaires sous forme de dividendes.
Les années 2001 à 2006 montrent ainsi le phénomène d’entraînement qui s’est instauré dans l’esprit des investisseurs. On achète des titres de style valeur par prudence parce qu’ils sont moins volatils et parce qu’ils donnent de gros dividendes. En principe, c’est raisonnable. Mais quel est le prix que l’on paie pour les actions qui offrent ces caractéristiques?
La figure 2 nous montre que relativement aux titres de croissance, les titres de style valeur sont essentiellement à leur prix le plus cher depuis 25 ans.
En réalisant que le cycle économique est bien durable, qu’il n’y a pas de risque de récession imminent, que la santé financière des consommateurs, des entreprises et des gouvernements est saine, que les occasions d’augmenter la productivité par l’entremise d’acquisitions et de sous-traitance partout dans le monde sont abondantes, la probabilité d’avoir de meilleurs rendements au cours des deux ou trois prochaines années semble donc plus élevée avec les titres de style croissance.
En terminant, même si l’on entend aujourd’hui plusieurs observateurs recommander l’achat de titres de petite capitalisation et de titres de style valeur, nous croyons qu’il y a lieu d’être prudent à cet égard puisqu’il faut continuer de toujours prendre en compte d’autres facteurs comme sa tolérance au risque, son horizon de placement et l’ensemble de son portefeuille avant de faire un choix d’investissement.